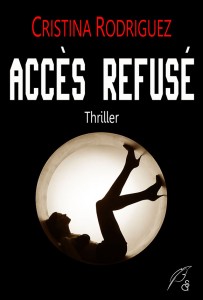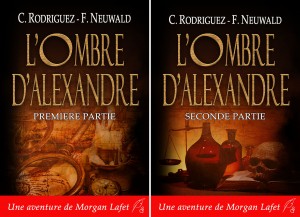 Morgan Lafet, helléniste émérite, passionné des mystères de l’archéologie, a longtemps arpenté les chantiers de fouilles avec son frère Etti, dont la mort le hante. Rongé par la culpabilité, il végète dans un « placard » du Louvre et se meurt d’ennui.
Morgan Lafet, helléniste émérite, passionné des mystères de l’archéologie, a longtemps arpenté les chantiers de fouilles avec son frère Etti, dont la mort le hante. Rongé par la culpabilité, il végète dans un « placard » du Louvre et se meurt d’ennui.
Mais le Destin a d’autres projets pour Morgan. Parmi les pièces d’une collection d’antiquités léguée par un historien, il découvre un glaive marqué du sceau d’Héphaïstos et le carnet de recherches du défunt, qui avait entrepris de retrouver le tombeau d’Alexandre le Grand.
L’aventure et les ennuis commencent.
De Paris à Sparte, en passant par l’Égypte, la Turquie ou l’île de Chypre, Morgan est entraîné autour de la Méditerranée dans une palpitante chasse au trésor, suivi de près par des aigrefins de tout poil, des collectionneurs véreux, des mercenaires, et des bandits sans scrupule…
Frédéric Neuwald, ancien superviseur d’effets spéciaux pour le cinéma, et Cristina Rodríguez, journaliste, chroniqueuse et romancière, nous offrent ici un roman palpitant, dépaysant et surprenant, dans plus pure tradition du genre. L’ombre d’Alexandre est le premier tome des aventures de l’archéologue Morgan Lafet.
DÉBUT DU LIVRE :
Il est quelque chose que j’ai retenu des anciens : certains signes annoncent sans doute possible une journée pénible. Quand vous vous réveillez avec la gueule de bois, seul dans votre lit, par exemple, et que vous trouvez un petit mot sur l’oreiller disant :
Je file, j’ai rendez-vous à 8 h à l’agence. Je t’appelle ce soir.
Bises, beau blond.
Cathia.
P.-S. J’ai éteint le réveil, tu avais l’air exténué.
— Merde !
Si le bracelet-montre indique alors 10 h 30, c’est que vous avez deux heures de retard. Si, de surcroît, il n’y a plus un seul t-shirt propre dans l’armoire et que la cafetière émet un bruit d’évier en vomissant une eau jaunâtre, mieux vaut se faire définitivement à l’idée que les Dieux vous ont pris en grippe.
Je songeai un instant à rester couché, mais nous étions mardi, et le mardi était le seul jour de la semaine où je pouvais être un peu tranquille au musée, puisque fermé aux visiteurs. Je me levai donc en tempêtant contre le mauvais alcool, les femmes inconscientes, l’aspirine, qui prenait toujours un malin plaisir à ne jamais se trouver là où on la cherchait, et tout ce qui tombait sous ma main ou dans mon champ de vision.
Après une douche et un rasage à l’eau froide, la chaudière ayant elle aussi décidé d’ajouter une virgule à la liste de mes contrariétés, j’enfilai mon t-shirt de la veille, un jean délavé usé jusqu’à la trame et une vieille paire de chaussures de randonnée. Je nouai bas sur ma nuque une queue de cheval approximative et jetai par habitude un regard critique au miroir de l’entrée. Les femmes me disaient souvent que je ressemblais à un acteur de péplum, avec ma carrure de gladiateur, ma tignasse blonde, mon sourire à fossettes de jeune premier et mes traits taillés à la serpe. Force était de constater que, ce matin-là, Ben Hur n’avait pas bonne mine. De sanglants vaisseaux striaient mes globes oculaires, le bleu de mes yeux avait viré au gris et la longue cicatrice verticale, qui me barrait le côté gauche du visage, ressortait plus que jamais sur ma peau à peine hâlée malgré la canicule qui sévissait depuis deux mois.
— Qu’en dis-tu ? demandai-je à la photo posée sur la commode de l’entrée. (Les yeux safran parurent me jeter un regard réprobateur et je souris.) Pas fameux, hein, Etti ?
Je soufflai sur la fine pellicule de poussière qui s’était accumulée et sentis un petit pincement au cœur. Quand avais-je pris cette photo, déjà ? Lors de notre dernier voyage à Delhi ? Où était-ce à Madras ? Qu’importait. Etti était souriant et gai, comme toujours. Sa chemise de lin blanc contrastait avec sa peau couleur châtaigne et ses cheveux d’un noir profond aux reflets presque bleus. Ses iris dorés illuminaient son visage aux traits délicats, si typiquement indiens. Les yeux d’un roi, pour moi. Des yeux que ses concitoyens ne voyaient pas puisqu’un dalit, un intouchable, doit les baisser en présence des représentants des castes « pures ».
Je n’avais jamais compris ce qui le poussait irrésistiblement à vouloir retourner en Inde, où il redevenait un moins que rien, guère plus qu’un chien. Quoique les chiens soient autorisés à laper un bol d’eau de puits en cuisine alors qu’Etti, lui, n’avait pas même le droit de poser le pied sur le perron de la maison.
« J’ai fait du mal dans une autre existence, disait-il, il est normal que je paye dans celle-ci. »
Qu’il fût ardemment croyant, bien que l’hindouisme l’ait relégué au rang de sous-homme, restait pour moi un mystère. Certaines de ses réactions me dépassaient. Quand elles ne m’amusaient pas…
« — Laisse cette souris tranquille, Morgan !
— Cette souris est dans ma cuisine.
— C’est peut-être ta grand-mère, ou ta mère ! Lâche ce balai !
— Par Zeus, Etti ! Ce n’est qu’une souris. Ça transporte tout un tas de saletés, ces bestioles !
— Fais du mal à cette pauvre bête et c’est en cafard que tu reviendras ! »
Indrani (c’est le nom qu’il donna à la demoiselle lorsqu’il l’adopta) nous fit ainsi profiter de sa rongeuse compagnie durant presque deux ans. Et que nul ne se flatte de pouvoir apprivoiser l’une de ces petites bêtes avant d’en voir une accourir à la mention de son nom, plonger dans la poche extérieure d’un sac à dos pour réclamer une promenade dans le jardin des Tuileries, ou attaquer la télécommande de la chaîne haute-fidélité quand la musique n’est pas à son goût. J’admets volontiers qu’Indrani était une souris hors du commun, mais de là à mériter des prières et des funérailles en grande pompe (avec offrande de miettes de biscuit et crémation dans l’évier sur lit de brindilles), c’était plus que mon sérieux ne pouvait en supporter. Etti avait donc officié seul dans la cuisine pendant que je me tordais de rire sur le divan du salon. Je revoyais son expression offensée lorsqu’il était sorti jeter les vénérables restes, dévotement rassemblés dans leur urne funéraire (une boîte à vermicelle), dans la Seine.
Il était comme ça et pour rien au monde je n’aurais voulu le changer.
— Etti…
Une sonnerie stridente retentit et je sursautai, manquant de peu renverser le cadre. Note pour plus tard : acheter un smartphone.
— Allô ? fis-je, le cœur battant.
— Morg ? J’te réveille ? Tu ferais bien de rappliquer, on a reçu un plein container de carburant à locomotives.
— Qui t’a donné mon numéro de téléphone fixe, Hans ? demandai-je, contrarié.
— On s’en fiche, ramène-toi, je te dis !
— Qu’y a-t-il ?
Un ricanement enfantin suivi de quelques jurons.
— Tu verras !
Je raccrochai en soupirant. Qu’avait encore inventé ce gamin décérébré ?
Le sac à dos sur l’épaule, je quittai mon appartement de la rue de Richelieu — merci, papa, d’être un spécialiste de l’Asie réputé à qui ses livres et ses émissions de télévision avaient permis de nous offrir à Etti et à moi ce coquet studio pour nos vingt ans — et récupérai mon courrier chez madame Risoti, la gardienne de l’immeuble. Il était presque onze heures et une bonne odeur ragoût en train de mijoter s’échappait de la loge. Depuis que je la connaissais, soit près de quinze ans, la pauvre femme passait un tiers de son temps à faire la cuisine, un autre à guetter l’arrivée d’un ouvrier du syndicat de copropriété qui, elle en était persuadée, allait installer des boîtes aux lettres pour la réduire au chômage technique, et le dernier à cancaner avec madame Fréon, la veuve du troisième.
Je dépiautai mon courrier devant elle, jetant publicité et billets d’information des Musées de France dans la corbeille de la loge.
— Attendez, Monsieur Lafet, piailla-t-elle de sa voix de canari, vous avez aussi un paquet.
Elle s’en retourna lentement — pour faire durer le suspens ? — et revint avec un petit colis timbré à Berlin.
— C’est Monsieur Lafet père, je suppose, dit-elle en frottant ses mains roses dodues.
Elle adorait appeler papa ainsi, moi-même ayant été promu « Monsieur Lafet fils » le jour où elle avait vu « Monsieur Lafet père » passer au journal de vingt heures, à l’occasion de la sortie de l’un de ses pavés sur l’Inde. Ce jour-là, nous étions devenus des gens importants pour madame Risoti, des personnalités dignes de poser dans ses revues people, aux côtés des acteurs célèbres et des têtes couronnées. Deux semaines plus tard, j’avais même poussé le vice jusqu’à lui faire croire que nous avions dû changer de nom à la Révolution française, passant de « de la Fet » à « Lafet », pour échapper aux persécutions. Je lui brossai le pathétique tableau de mes ancêtres, marchant nu-pieds dans la neige, serrant nos armoiries familiales dans leurs doigts gelés et « vous savez, Madame Risoti, il faisait fichtrement froid, à cette époque, au mois de juillet ! ». Etti m’avait reproché durant plus d’une semaine d’avoir mené cette commère en bateau, et pourtant Zeus savait à quel point la chère Risoti le détestait.
« — Il faudra dire à monsieur Etti de ne plus ouvrir les fenêtres, quand il fait sa cuisine pakistanaise. Les voisins se sont plaints de l’odeur ! Il n’est plus au pays.
— Je ne trouve pas l’odeur du curry désagréable, madame Risoti, et pour la énième fois : Etti n’est pas pakistanais. »
— Ces gens-là, vous savez, ils se ressemblent tous. »
— C’est aussi ce qu’il pense des Européens… »
— Monsieur Lafet père va bien ? demanda-t-elle en suivant les mouvements de mes doigts de ses yeux curieux. (Je ne répondis pas et jetai papier d’emballage et ruban dans sa corbeille.) C’est bien de voyager comme ça. Mon fils, l’année dernière, il est parti à New York pour son travail. Il a eu une promotion, je vous l’ai dit ?
— À neuf ou dix reprises, cette semaine. (Le contenu du paquet, une espèce d’imbroglio de longs poils roux et de ficelle, dégageait une odeur de moisi.) C’est bien une idée de papa, ça !
— Qu’est-ce que c’est ? Un petit masque ? C’est africain, non ?
Je le lui tendis avec un sourire séducteur.
— En quelque sorte. Il vous plaît ? Je vous l’offre !
— Oh ! Monsieur Lafet, non. C’est un cadeau de Monsieur Lafet père. Je ne…
— Allons, insistai-je, charmeur. Vous me vexeriez en refusant. Cette pièce est une antiquité, vous savez. Je peux vous assurer que personne dans le quartier n’en possède une semblable. Chacune de ces œuvres est unique et elles portent chance. Tenez, nous allons l’accrocher par les poils au-dessus des casiers. Enfin, par les cheveux.
Ravie, elle brandit une punaise et j’épinglai le cadeau de papa dans le vestibule de la loge, bien en évidence.
— Monsieur Lafet, minauda-t-elle, je ne sais pas quoi dire. Je suis très touchée, vraiment. C’est fait en quoi ? On dirait de la terre cuite, non ?
— Fabrication artisanale. Recette secrète, ajoutai-je avec un clin d’œil.
— Oh !
Je filai au Louvre avec deux bonnes heures de retard, laissant madame Risoti s’extasier devant son « antiquité ». M’offrir une tête réduite en souvenir de ses voyages… C’était de l’Antoine Lafet tout craché !
*
Nous étions à la fin du mois de juin, le soleil tapait sec et ce fut avec un plaisir non dissimulé que je pénétrai dans l’atmosphère climatisée du Louvre. Les grandes allées dégagées me donnaient toujours une curieuse impression de gâchis. Tant de murs nus, de couloirs trop larges, de place inexploitée alors que des collections entières dormaient dans les caves… Mes semelles crissaient sur le dallage et mon souffle paraissait rauque, amplifié par les longs corridors désespérément vides. Le mardi, le musée prenait des allures de tombeau, il sentait la pierre moussue, la peinture rance et le vieux parquet. On pouvait rapidement se surprendre à déprimer, si la promenade dans les salles dépeuplées se prolongeait.
Je me faufilai donc dans les sous-sols, où se trouvait mon bureau avec une certaine hâte. La vie et l’agitation qui y régnaient me firent très vite oublier le silence sépulcral des étages supérieurs. Dans les galeries souterraines, des manutentionnaires en bleu de travail se démenaient comme des termites, déplaçant caisses ou palettes.
Un curieux relent de naphtaline me saisit soudain à la gorge et une poussière jaunâtre se déposa sur mon t-shirt noir.
— Salut, Morg ! lança Hans.
Il portait un petit plateau en plastique débordant de gobelets de café, dont le parfum masqua un instant celui de l’antimite.
Ce jeune hurluberlu m’était tombé dessus comme la foudre au cours du mois de juin. Hans était le petit-fils de Ludwig Peter, l’un des meilleurs amis de mon père, un célèbre helléniste qui avait parrainé ma thèse sur les sociétés militaires en Grèce durant la période classique. Le brave homme s’était mis en tête de faire de ce fils à papa virevoltant un historien studieux. Il m’avait donc prié de lui trouver une place de stagiaire au Louvre, ce que, à mon grand dam, je n’avais pu refuser. Je n’entrevoyais pas l’ombre d’une solution pour intéresser à l’antiquité cet éphèbe efflanqué de vingt ans, plus exalté qu’un chihuahua cocaïnomane. Il ne pensait que « glisse », « techno », « gonzesses » et « style » (qu’il prononçait « staaaïïïle »), le « staïle » regroupant selon toute vraisemblance le « look » et les occupations en opposition totale à ceux des « has been », dont, d’après ses critères, je faisais probablement partie.
Sa maigre carcasse zigzagua adroitement entre les ouvriers et je pris un gobelet sur le plateau.
— J’ose espérer que tu n’y as rien versé ? lui demandai-je en grimaçant.
— On ne donne pas des pépites aux cochons.
— Des perles, le repris-je. Qu’est-ce qui empeste à ce point ?
Il fit un petit pas de danse et chassa une mèche décolorée de son front.
— Va voir dans ton bureau !
Je haussai le sourcil.
— Dans mon bureau ?
Hans sautilla sur place et fit une moue qui creusa ses fossettes.
Dans quelques années, il serait sans conteste un homme séduisant, mais, pour l’heure, il exhibait des allures gauches d’adolescent qui n’en finissait pas de se développer. Ses jambes et ses bras, couverts d’un duvet brun, étaient trop longs par rapport à son buste, qui commençait à s’élargir, et ses joues poupines, piquées d’une barbe clairsemée, le faisaient paraître plus jeune encore qu’il ne l’était réellement.
Il abandonna son plateau sur une caisse et je le suivis au « B.A.S. », comme il disait. Le « Bureau de l’Allumé de Service ». Moi. En fait, j’étais le responsable — et le seul membre — d’un organe de recherche créé tout spécialement pour moi avec l’aimable contribution, et un soupçon de chantage, de notre vénéré directeur Jean de Villeneuve. Un tire-au-flanc qui dissimulait plus de squelettes dans ses placards qu’un ayatollah, une manne pour un archéologue peu sourcilleux à la recherche d’une « planque », loin des chantiers de fouilles. Comme les scrupules ne m’ont jamais étouffé, j’avais donné à ce quinquagénaire le choix entre une dénonciation en bonne et due forme pour « recel de matériel archéologique » — plus prosaïquement une superbe collection de vases grecs exposés dans sa maison de campagne de Trouville et vendue par un trafiquant d’antiques de ma connaissance –, ou la création d’un département de « Dossiers archéologiques sans suite », dirigé par votre serviteur. Son amour de la science et son respect pour la recherche le firent immédiatement pencher pour la seconde solution.
Noble âme…
Depuis presque un an et demi, je passais donc le plus clair de mon temps à compiler et étudier ce que l’on appelait les « énigmes de l’archéologie », décortiquant les rapports de découvertes les plus insolites, de la machine d’Anticythère à des piles électriques de plus de deux mille ans, trouvées sur le site parthe de Khujut Rabu, près de Bagdad. Et ce ne sont là que des exemples parmi d’autres. Je mettais régulièrement le fruit de mes analyses à disposition des internautes et des chercheurs sur mon blog. Par des moyens plus que discutables, j’avais obtenu de Villeneuve un ordinateur dernier modèle ainsi qu’une place sur le serveur du Louvre pour pouvoir y accumuler mes données.
Lorsque je poussai la porte de mon bureau, le relent de naphtaline mêlé de myrrhe qui flottait dans les sous-sols m’irrita le gosier et je n’eus aucun mal à en deviner la provenance.
— Surprise ! railla Hans en voyant ma mine défaite.
Claquant le battant, je courus plus que je ne marchai vers l’escalier qui menait aux derniers étages — la direction. Là aussi, l’agitation était à son comble, mais je fis irruption dans le bureau de Villeneuve ou, devrais-je dire, dans l’annexe officieuse du musée. En effet, notre cher directeur ratissait régulièrement les sous-sols à la recherche des tableaux de maître et des statues antiques non exposées pour s’en entourer.
— Auriez-vous confondu mon office avec une morgue ? demandai-je d’une voix glaciale, pétrifiant Villeneuve et les deux conservateurs qui lui présentaient une série de plans et de tableaux statistiques.
Le maître les lieux fronça ses épais sourcils.
— Je vous demande pardon, Lafet ?
Je refermai la porte et pris une profonde inspiration.
— À l’heure où je vous parle, cinq momies moisissent dans mon bureau. Suis-je supposé travailler en leur joviale compagnie ?
Il s’affala dans son fauteuil et me jeta un regard venimeux par-dessus le bout de ses doigts joints, se mordant la langue pour ne pas me remettre sèchement à ma place — ce qui lui aurait valu de sérieux ennuis, il en était pleinement conscient. Même de là où j’étais, je pouvais sentir la délicate fragrance que son corps gras dégageait, nonobstant la climatisation. Une savante composition de sueur, d’eau de toilette à la bergamote et d’effluves amers qui devaient être la matérialisation olfactive de son esprit corrompu.
L’un des conservateurs, un homme engoncé dans un pantalon de lin vert bouteille et une chemise à carreaux bleus et blancs, lui évita une réponse bredouillante. Il laissa échapper un timide filet de voix en réajustant ses lunettes.
— Nous avons eu à déplorer de petites difficultés avec l’exposition sur les momies gréco-romaines de Bahariya, Professeur Lafet. Quarante-cinq sarcophages ont été livrés, alors que nous n’en attendions que trente-quatre. Votre office étant l’une des trois pièces climatisées des sous-sols, j’ai estimé que…
— Vous estimez mal. Il est hors de question que je partage mon bureau avec ces cinq malheureux durant un mois parce qu’un imbécile, perdu dans son oasis à quatre cents kilomètres au sud-ouest du Caire, ne sait plus compter !
— Rassurez-vous, Professeur Lafet, bredouilla le petit homme en se tordant les doigts. Nous allons les renvoyer dès que possible. Au plus tard en début de semaine prochaine.
Villeneuve se redressa, dans les limites permises par sa masse adipeuse, et posa lourdement les paumes à plat sur son sous-main pour me fusiller du regard.
— Vous n’aurez pas besoin de votre bureau dans les jours à venir, Lafet. (Il sortit un dossier bleu d’un tiroir et le fit glisser vers moi sur le plateau de chêne du secrétaire.) Vous partez faire un inventaire à Fontainebleau. À Barbizon, plus exactement.
Je ne sais quelle tête je fis en cet instant, mais je me rappelle parfaitement celle de mon supérieur. Il blêmit en un clin d’œil et son cou épais s’enfonça de quelques centimètres dans le col de sa chemise. À sa décharge, il faut reconnaître qu’il existe peu d’hommes capables de soutenir un regard meurtrier lorsqu’il est jeté par une sorte de Viking herculéen balafré d’un mètre quatre-vingt-quinze.
— Un inventaire ? murmurai-je, menaçant. Moi ?
Voyant que je restais à distance respectable — ou plutôt que lui demeurait hors de portée –, Villeneuve se racla bruyamment la gorge, tâchant de recouvrer un semblant de dignité.
— Vous vous doutez bien que je ne vous aurais pas proposé ce travail sans raison, Lafet.
— Je l’espère, rétorquai-je avec un sourire de requin.
— Vous connaissiez bien le professeur Lechausseur, je crois ?
Je tiquai et luttai contre la vague de souvenirs qui menaçait de déferler.
— Bertrand Lechausseur ? Le latiniste ? Je le connais très bien, en effet.
Mon cœur se mit à battre la chamade. Corinthe… Les fouilles dirigées par Bertrand. Mon dernier chantier. Nous avions repêché une partie de la cargaison d’une galère romaine, datant du temps de Néron, qui avait coulé corps et biens à l’époque où l’empereur citharède avait entrepris de percer le canal. Etti… Un an et demi, déjà !
Une main ferme se posa sur mon épaule et je tressaillis.
— Bertrand est mort la semaine dernière, Morgan, intervint le second conservateur de sa voix de baryton. (J’eus l’impression de recevoir un coup en pleine poitrine.) Il a fait une chute de son balcon.
Je me tournai vers lui, désorienté. François Xavier était le conservateur des collections égyptiennes, un homme discret et efficace, l’un des rares qui semblait prendre son travail au sérieux, et avec qui je m’entendais fort bien. Son élégance et son flegme tout britannique trahissaient immédiatement son ascendance anglaise, contrairement à son nom.
— Un malaise ? parvins-je à articuler.
Villeneuve fit claquer sa langue contre son palais.
— Ou une agression, murmura-t-il.
Je sursautai.
— Chez lui ?
— C’est ce qu’affirme le rapport de police. Et, pour couronner le tout, Lechausseur, dépourvu d’héritiers, fait don de sa collection au Musée du Louvre. Je me demande bien ce que nous allons en faire ; les caves débordent.
Je sentis la main de François, aussi choqué que moi par le ton désabusé, se contracter sur mon épaule.
— Refaire la décoration de votre bureau ? persiflai-je. (Les joues de Villeneuve, cramoisies, tremblotèrent comme de la gelée.) Ou celle de votre maison de campagne, peut-être ? (Il sera son gros poing, comme s’il brisait quelque chose entre ses doigts — moi, probablement.) Il ne faut pas s’offrir des fantasmes au-dessus de ses moyens, Monsieur de Villeneuve.
Je saisis le dossier et m’en allai en claquant la porte, dévalant l’escalier jusqu’aux sous-sols pour m’enfermer dans mon bureau en compagnie des momies, qui m’étaient totalement sorties de l’esprit.
Je m’affalai sur ma chaise et remplis à demi mon mug à café avec le fond de la bouteille de scotch oubliée par mon précédent stagiaire dans le tiroir de mon secrétaire. Je bus d’un trait. L’alcool me brûla la gorge et me tomba sur l’estomac comme de la roche en fusion, mais ne me soulagea en rien. Une sueur froide me coulait le long du dos et dans les yeux. Je la chassai d’une main tremblante et mes doigts, comme par inadvertance, caressèrent la longue cicatrice verticale qui me barrait le visage.
Bertrand Lechausseur…
J’entendais encore ses cris résonner à mes oreilles sur le bord du canal de Corinthe.
«— Attention ! Professeur Lechausseur, la paroi va s’effondrer !
— Ramenez les plongeurs ! Par tous les Dieux, faites-les remonter !
— Mais professeur…
— Morgan, que faites-vous ? Êtes-vous fou ? Vous risquez d’être enseveli ! Morgan ! Je vous interdis de plonger, vous m’entendez ? Je l’interd… »
L’eau glacée, le sel dans la bouche et la sensation de nager dans de la poix, comme dans ces rêves où l’on se démène pour courir, mais où l’on n’avance pas. Le soulagement, à la vue de cinq hommes en tenue de plongée, remontant vers la surface, me faisant signe que tout allait bien.
Puis, soudain, le brouillard. Une tempête de sable sous-marine silencieuse, des courants anarchiques provoqués par la chute de dizaines de tonnes de marbre et de mortier dans le fond du canal. L’affolement. La peur. Où est le haut ? Où est le bas ? Le masque de plongée arraché et la douleur. Les bras et le visage déchirés. Le sang qui se mêle au sable et à l’eau de mer. Une main qui vous tire par les cheveux et l’air, la surface, enfin. Le bruit, à nouveau, les cris…
«— Il est blessé ! Vite ! Appelez une ambulance !
— Il manque un plongeur ! Il manque un plongeur !
— Morgan ! Morgan, vous m’entendez ? Mais que fait cette ambulance ?
— Etti…
— Il est conscient, professeur.
— Professeur Lechausseur, il manque un plongeur ! Il n’est pas remonté ! Il est resté sous les blocs !
— Oh ! Mon Dieu ! Il faut aller le chercher !
— C’est trop tard, professeur ! Il faut nous occuper de celui-ci. »
D’un geste rageur, je balayai tout ce qui se trouvait sur mon bureau et la tasse se brisa sur le carrelage. J’avais du mal à respirer, comme si chaque muscle de ma cage thoracique se contractait sur mes poumons.
— Pardon, Etti… Pardon.
Je pressai mes mains sur mon visage, mais savais que mes yeux resteraient secs. Je ne savais pas pleurer. Je n’avais jamais su.
*
— Cela devrait suffire, fis-je en tapotant le couvercle du sarcophage que Hans m’avait aidé à déplacer, à grand-peine, contre l’un des murs de mon bureau. Tu devrais te remplumer un peu, mon grand !
Mon stagiaire soufflait comme une locomotive et transpirait à grosses gouttes.
— Moi, je ne me shoote pas aux anabos ! rétorqua-t-il en se dressant sur la pointe des pieds dans le vain espoir de me torpiller du regard.
Je lui répondis par un sourire goguenard et fis gonfler mon biceps, aussi gros que sa cuisse.
— Navré de te décevoir, mais c’est 100 % bio.
Il se renfrogna et se laissa tomber dans mon fauteuil en maugréant je ne sais quelles douceurs dont il avait le secret. Je passai délicatement le doigt sur la peinture récemment écaillée du sarcophage et grimaçai. Les manutentionnaires avaient occasionné plus de dégâts en le faisant entrer par la porte que le temps en quelques centaines d’années. Pourquoi diable avait-on sorti ces momies de leurs caisses ? Et si un conduit d’eau se mettait à fuir ? Je levai le nez vers les vieilles tuyauteries et, après un instant d’hésitation, recouvris les sarcophages d’une bâche en plastique, que j’allai chercher dans la réserve. Mieux valait ne pas tenter la malchance, surtout après une matinée pareille.
— Bon, on y va quand, à ton patelin de gribouilleurs ? s’impatienta Hans. Ça craint à fond, ici !
Je pris sur moi pour ne pas répliquer vertement.
— Pourquoi ton grand-père ne t’a-t-il pas plutôt envoyé faire un stage de randonnée ou d’escalade ?
— T’es vraiment à l’Ouest, toi ! s’esclaffa-t-il. (Je levai un sourcil.) Eh ! ouais, papy, on a inventé le trekking depuis les pattes d’eph’. (Il jura.) Si tu crois que je n’aurais pas préféré me tailler aux championnats de rampe de Sydney plutôt que de m’emmerder ici…
« Et moi donc ! » pensai-je.
— Quatorze heures, fis-je en regardant sa montre.
Il fallait partir, en effet. Les policiers devaient déjà être sur place et l’inspecteur que j’avais eu au téléphone ne paraissait pas homme à lésiner sur la ponctualité. Il m’avait aimablement assuré que je pouvais me rendre chez Lechausseur « quand je le désirais, mais bon, si cela pouvait être aujourd’hui avant dix-sept heures, n’est-ce pas… ».
Je pris mon sac à dos et Hans bondit sur ses pieds.
— Les flics seront là ? (J’acquiesçai, lugubre.) Il y aura un périmètre de sécurité, alors ? Avec les trucs en cire sur les serrures, les bandes jaunes, le dessin blanc par terre et tout le tremblement ? La classe !
Je préférai ne pas épiloguer et lui désignai la porte, qu’il franchit avec un cri de singe hurleur. Comment allais-je pouvoir supporter cet énergumène jusqu’en septembre ?
Nous passâmes prendre une douche — froide — chez moi, Hans habitant le petit huit pièces de papa à Neuilly-sur-Seine, et j’eus la chance de retrouver au fin fond de mon armoire un t-shirt propre estampillé du panda de l’association W.W.F., un cadeau de mon père.
Nous récupérâmes ma vieille 104 au parking et là, je sentis mon stagiaire sur le point de se rendre à Barbizon à pied.
— Ça existe, comme bagnole, ça ? éructa-t-il. C’est un truc que t’as bricolé toi-même ou quoi ?
— Ce « truc », c’est ma voiture et c’est elle qui va gentiment nous conduire à bon port malgré ses 233 000 km au compteur. Allez, grimpe, elle ne mord pas.
Je m’installai derrière le volant et balayai de la main les paquets de gâteaux éventrés, prospectus, revues et bouteilles d’eau minérale vides pour que Hans puisse s’asseoir, ce qu’il fit avec une réticence pour le moins blessante. Il tira sur le fermoir de sa ceinture de sécurité et ce dernier lui resta dans la main.
— La place du passager ne sert pas souvent. Accroche-toi au siège, Robin.
— Euh… Il ne lui manquerait pas quelques options, à ton mixer ? Genre levier de vitesses.
Il pointa du doigt la tige métallique qui saillait du plancher, entre nous deux. Je mis le contact et manipulai le levier sans aucune difficulté.
— Le pommeau s’est fait la belle il y a deux ans.
Il ferma les yeux en soupirant et j’allumai une cigarette avant de sortir du parking.
*
La maison de Lechausseur était un coquet petit pavillon agrémenté d’un jardin à la lisière de Barbizon, en orée de la forêt de Fontainebleau. Lorsque nous arrivâmes sur les lieux, Hans sortit de la voiture en inspirant avec soulagement l’air parfumé des sous-bois.
— T’as jamais entendu parler des petits sapins qu’on accroche au rétro, pour éviter les odeurs de clope et de vieille ferraille ? Ça se marierait pile-poil avec ta ruine. (Il renifla ses vêtements de sport avec une moue.) Oh ! La vache…
Je refermai ma portière et écrasai ma cigarette.
Sur le perron, deux policiers en uniforme faisaient le pied de grue et je réprimai un frisson en voyant les scellés à l’entrée de la maison. Je m’approchai en tendant aimablement la main.
— Bonjour. Je pense que c’est nous que vous attendez. (Les deux hommes échangèrent un regard perplexe et me détaillèrent de haut en bas, les yeux écarquillés.) Nous sommes envoyés par le Louvre, précisai-je. J’ai appelé, tout à l’heure. L’inspecteur Dalesme m’a assuré que…
— C’est vous, l’historien ?
— Morgan Lafet, oui. Merci d’avoir permis que nous commencions aussi rapidement.
— Morgan Lafet ? releva le plus jeune en levant un sourcil roux.
Hans pouffa et je pinçai les lèvres. Combien de fois n’avais-je pas maudit papa pour ce grotesque jeu de mots !
— C’est encore plus drôle à l’envers, essayai-je de plaisanter. (Les policiers eurent le bon goût de sourire et serrèrent enfin ma main tendue.) Et voici Hans, mon… assistant.
— Je suis le lieutenant Rugelio Salgado.
— Agent Lionel Lecari, se présenta son confrère.
— Si vous êtes prêts, nous pouvons y aller.
Je pris une profonde inspiration, hochai la tête, et Hans sautilla sur place, impatient. J’aurais aimé pouvoir faire preuve d’autant d’enthousiasme que lui !
(Fin de l’extrait)
LIRE CE ROMAN :
Version numérique Kindle en deux parties : Partie I /Partie II :
Version numérique Epub en deux parties : Partie I/Partie II
Version bochée : Cliquez ici
Découvrez aussi le roman de Cristina Rodríguez :
“ACCÈS REFUSÉ”
Version numérique Kindle en deux parties :
Partie I /Partie II :
Version numérique Epub en deux parties :
Partie I/Partie II
Et retrouvez Cristina Rodríguez
sur Facebook :
https://www.facebook.com/cristina.rodriguez.auteur